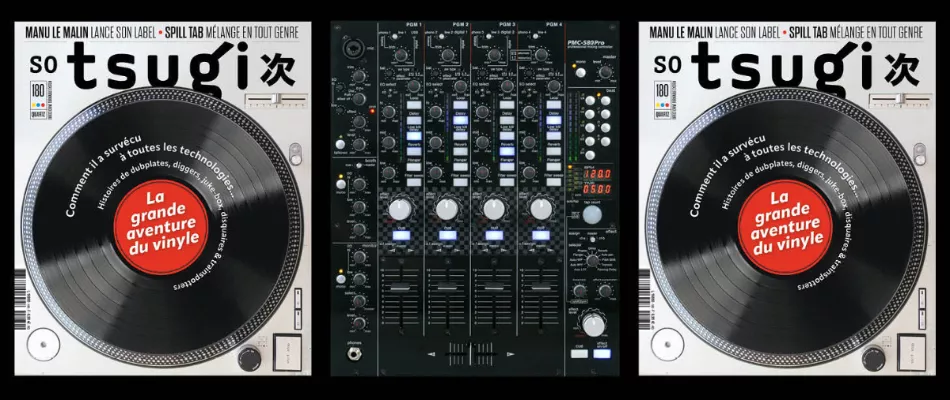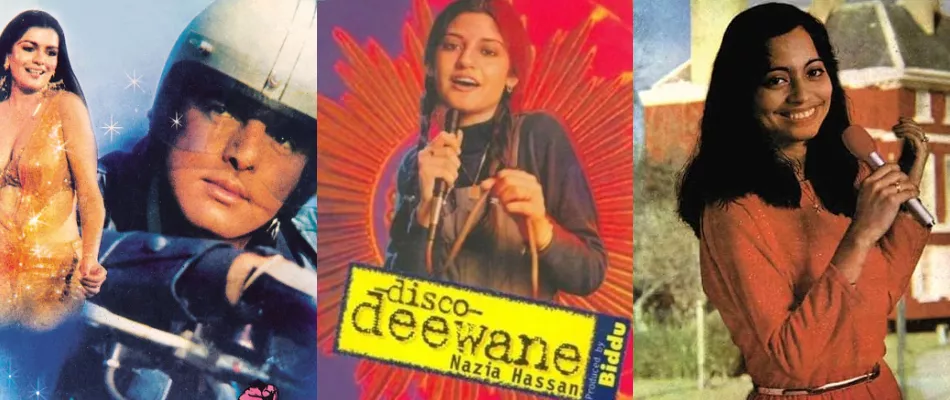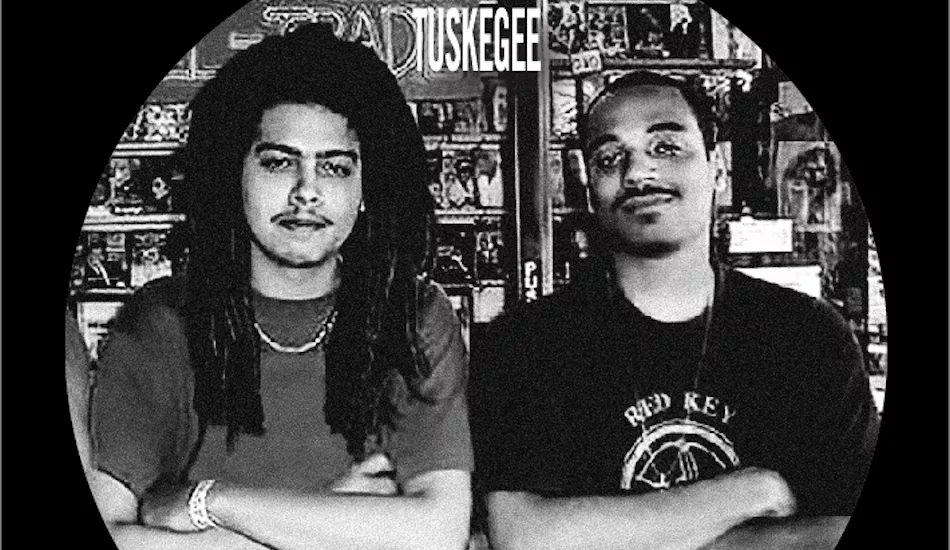Au gré de ses voyages, entre Californie, Angleterre ou France, Nelson Beer s’est construit un univers à lui pour devenir un artiste atypique. Avec sa pop musique sensible aux mille influences, il explore les thématiques du genre, de l’amour et des relations sociales dans des morceaux aux sonorités à la fois électronique et r’n’b. Nous l’avons rencontré pour parler de tous ces sujets, en attendant de le retrouver à l’affiche du Pitchfork Music Festivalà la Grande Halle de La Villette le vendredi 1er novembre prochain.
Tu es né en Suisse et tu as vécu entre Etats-Unis, Angleterre et France. D’où te vient ce besoin de bouger tout le temps ?
C’est finalement plutôt par accident car j’ai fait des choses différentes dans chaque pays où j’ai vécu. Je suis né et j’ai grandi en Suisse, je suis parti à la recherche de moi-même aux Etats-Unis, j’ai fait un Master de recherche géopolitique en Angleterre et je suis venu m’installer à Paris pour poursuivre la musique. Vivre dans ces cultures occidentales m’a surtout appris que mon identité est multiple, et qu’elle peut changer en fonction d’où je suis et de comment je vis, qu’elle est au centre de mes interactions avec tout ce qui m’entoure et que mon environnement façonne qui je suis. C’est intéressant de penser que l’identité n’est qu’une histoire qu’on se répète tous les jours à soi-même, et que cette histoire, qu’on le sache ou non, est extrêmement influencée de ce qu’on perçoit tous les jours, ce qu’on apprend sans nécessairement s’en rendre compte. Il y a une énorme force appliquée sur chacun d’entre nous qui est celle de l’histoire, des différents milieux, des infrastructures invisibles qui modèrent notre corps dans ces infrastructures physiques. Je crois simplement que j’essaie constamment d’échapper à une forme d’identification. (rires)
J’ai lu que tu avais suivi une formation classique au piano et que tu étais fan de skate, ces deux pratiques sont-elles compatibles ?
Je dirais que ce sont deux pratiques qui demandent beaucoup d’auto-discipline, chose que je n’ai jamais vraiment eue… Mais ce sont aussi des pratiques de jeu, d’improvisation et d’agilité, et ça ça me plaisait beaucoup plus. Le skate comme le piano classique sont des pratiques aussi douloureuses que satisfaisantes, ce sont de bonnes manières de s’échapper du quotidien, de sortir du cocon familial et de s’exprimer librement, à travers une forme d’improvisation: en imitant les autres on y ajoute un peu de soi et on se forme une identité créatrice, une force de pouvoir s’affirmer dans un milieu, puis dans n’importe quel milieu. C’est un exutoire qui permet de parler de soi et des autres à travers le jeu, l’improvisation et la créativité. J’utilise la musique pour libérer dans un premier temps mes émotions, ce qu’il y a à l’intérieur de moi, mais également dans l’idée de les partager avec les autres, mes amis, mes proches. J’y vois une sorte d’universalité dans un langage émotionnel et identitaire. C’est en cela aussi que ces deux activités peuvent se rejoindre: elles sont des expressions corporelles de notre environnement, dans notre environnement. Un miroir de soi et donc des autres.
J’ai vu également que tu avais travaillé dans une galerie d’art et que tu avais alors appris à interpréter les oeuvres, à en parler. Ça t’a apporté beaucoup pour lancer ton projet ?
Je me projette dans des mondes pour composer, tout vient d’abord d’une émotion, d’un désir ou d’un souvenir. Mais il est vrai que les choses qui m’entourent ont tendance à affecter ma vie et donc mon travail. Je ne pense pas qu’avoir parlé des oeuvres des autres m’ait aidé à parler des miennes mais je pense qu’elles m’ont ouvertes sur des mondes que je ne connaissais pas encore. Comme avec la musique, j’ai découvert plein de groupes, de mouvements musicaux que je ne connaissais pas ou auxquels je ne portais pas d’attention. Certaines oeuvres sont des miroirs de la société dans laquelle on vit, on y découvre des cultures différentes, des courants de pensées; dans la musique c’est pareil, ce sont des nids d’histoire et de références… C’est vrai que ma musique est assez référencée, il y a des influences que tout le monde n’a,pas et, comme lorsqu’on interprète une oeuvre, il faut y passer un peu de temps, peut-être aller écouter d’autres choses… j’essaie de faire des mixes de temps en temps pour alimenter ma musique avec celle des autres. Je pense que c’est un bon moyen pour entrer dans l’univers d’un artiste.
Beaucoup de gens critiquent de manière négative la musique qualifiée comme » pop « . Elle représente quoi pour toi ?
Je comprends le côté négatif qui est associé à la musique populaire. Mais pour moi la pop musique ça peut être du rap, de la country, de la techno, de la post-rave, du rock progressif, du metal… La musique que l’on qualifie d’underground finit toujours par faire surface dans la discographie des artistes plus mainstream. Par exemple, je pense qu’XXXTENTACION c’est de la pop et pourtant c’est très expérimental: son morceau « Look At Me! » par exemple c’est presque du metal et dans l’instrumental il y a un sample de Mala, un des pionniers de la dubstep Londonienne du début des années 2000. Ce qu’on appelle pop music c’est certainement la musique underground que l’on finit par accepter dans une économie mainstream, mais cela peut aussi être de l’expérimentation qui reste dans les limbes d’internet, et dans ce cas on parlerait plutôt de musique expérimentale ou d’underground. Je suis tombé sur un tweet de Holly Herndon qui disait « what is pop music anyway ? ». Je pense honnêtement que c’est la forme la plus transversale de musique car elle est impossible a mettre dans une case et pourtant elle transperce les cultures. D’un autre côté, le terme est sûrement biaisé par nos habitudes de consommation de la musique. Aujourd’hui le format de l’album n’existe plus beaucoup. Nous carburons au Single, des morceaux qui ont très souvent une durée de vie très courte et qui sont rapidement remplacés par de nouveaux morceaux. C’est peut-être le problème principal de ce que l’on qualifie de « pop music »… Il n’y a pas vraiment une » scène » mais plutôt une industrie derrière. Ce que la musique underground a de plus fort c’est qu’elle est soutenue par une niche d’amateurs de musique; souvent une base solide qui soutient les artistes indépendants alors que la « pop music » est plus souvent consommée puis jetée.
Tu fais de la pop mais il y a également beaucoup de sonorités électroniques et même r’n’b comme dans « Nadya » ou » Numb » , ça te vient d’où toutes ces inspirations ? C’est de là que vient ton envie de chanter en anglais et en français ?
J’ai quasiment tout aimé: du rock progressif de Todd Rundgren, au metal androgyne de Bad Brains, à la techno de Omar S, la juke de DJ Slugo, le jazz mélodique de Yusef Lateef, en passant par les concepts albums de Kanye West, le gospel de LaShun Pace, la musique minimaliste de Steve Reich, les sonorités expérimentales de Pan Sonic, la musique ambient de Brian Eno mais aussi la disco, le ballroom, bref… beaucoup de musiques noires cela dit, ou nées d’une forme de révolte, d’anticonformisme ou d’une nécessité de transformer les espaces parfois trop étriqués. Toutes ces musiques sont si étroitement liées que c’est difficile de ne pas reconnaître les traits de famille. Le R’n’B vient du blues, suivi du jazz, du gospel, comme le rock; la techno répondait à la disco, aux contre-cultures, dans l’idée de rassembler et de danser dans un corps commun… Quasiment tous ces genres, si l’on remonte à leurs origines viennent des états unis pendant des périodes industrielles ou d’exploitation du labeur, du corps humain; la disco vient d’une forme de révolte des homosexuel.le.s de couleur contre la stigmatisation des musiques queer et de la dominance du rock… Mes chansons ne sont que le reflux naturel de ces musiques que j’ai tant écouté et qui m’ont fait danser, rire et pleurer. Je pense que la révolte est inhérente à la musique et que si elle se retrouve dans la mienne c’est que ces musiques révolutionnaires sont indestructibles et portent avec elles un message toujours plus puissant. En ce qui concerne le choix des langues, c’est un choix plus personnel : le français est ma langue maternelle. Je l’utilise lorsque je dois me rapprocher de mon coeur et de mon intimité, de transmettre des sensations personnelles. L’anglais pour moi est un échappatoire, un endroit qui me laisse rêver et parler de choses abstraites, fictives, des identités rêvées…
Il y a une réflexion sur la sexualité, l’amour et les questions de genre qui est assez présente dans tes morceaux et clips. Un sujet que l’on retrouve par exemple dans le morceau « I Am A Woman ». C’est un thème qui t’inspire, te tient à coeur ?
Je réfléchis beaucoup à comment accepter les nouvelles formes, qu’elles soient sexuelles, animales, végétales, non concevables par l’humain. Par exemple l’Anthropocène, cette période dans laquelle nous vivons qui a pour but de connecter le globe dans son entièreté, créé des objets impossible à concevoir, des « hyperobjets » (voir le travail de Timothy Morton, ndr). Elle engendre des mutations de la planète et nous devons en accepter certaines et changer radicalement nos modes de vie pour le faire car nous en sommes tous responsables. Pour le morceau « I Am A Woman », c’est surtout venu d’un désir de s’accepter soi-même, d’accueillir la féminité dans la masculinité ou vice versa, de remettre en question le rôle du performer masculin et de l’emmener dans des espaces différents. Il faut comprendre que le monde change et que notre histoire, si même importante et poétique est parfois très violente et a besoin d’être remise en question.
Tu produis (ou coproduis) tes clips, c’est un choix ? Pour garder le contrôle sur ta création ?
L’idée est généralement de me mettre à nu, me dévoiler, que ce soit dans ma musique, mes performances ou dans mon travail visuel. C’est personnel, on peut même dire que c’est très intime. Pour l’instant j’ai travaillé plus ou moins seul mais à terme j’espère avoir l’opportunité de travailler avec tous ces artistes géniaux qu’il y a là dehors.
Tu joues bientôt au Pitchfork Music Festival parisien et tu as déjà joué au Fnac Live et aux Trans Musicales de Rennes. C’est important pour toi d’être à l’affiche de festivals ou le but à terme c’est de faire des dates solo ?
C’est bien de jouer devant des personnes qui ne sont pas forcément venues te voir. Mais je n’aime pas forcément ce format car j’aime pas du temps sur la scénographie et je trouve que les festivals restreignent un peu dans ce sens là, ce sont plus des showcases, souvent de jour, et il est plus difficile de raconter une histoire dans un format « supermarché » comme ça. J’aime bien avoir le temps pour proposer une expérience scénique. Jouer trente minutes c’est déjà bien mais à terme oui, j’aimerais bien avoir mes propres dates, jouer tard la nuit et faire la fête. Par contre jouer pendant les festivals d’été ça reste très cool, il fait chaud, on s’ambiance bien et tout (rires).
Et du coup c’est quoi la suite pour toi ? Un album ?
J’ai un nouveau single qui est sorti la semaine dernière qui s’appelle « Modern Love ». C’est un morceau plus posé dans un style assez hip-hop et qui parle de l’amour propre à l’aube de l’hyper-société. Je joue donc au Pitchfork Festival à la Villette le vendredi 1 novembre et dès que tout ça est passé, je m’enferme dans le studio jusqu’à Noël (rires). J’ai pour projet de faire un premier EP long, d’environ six titres. J’ai déjà commencé à me pencher sur plusieurs morceaux. Je pense que ça va bien m’occuper pour rester au chaud cet hiver.
Pour ceux qui veulent venir voir Nelson Beer sur scène le 1er novembre au Pitchfork Music Festival, la billetterie est dispo juste ici.
Les deux premiers EP Oblique et Oblique II de Nelson Beer sont disponibles à l’écoute juste ici :
Ainsi que son dernier morceau « Modern Love » :