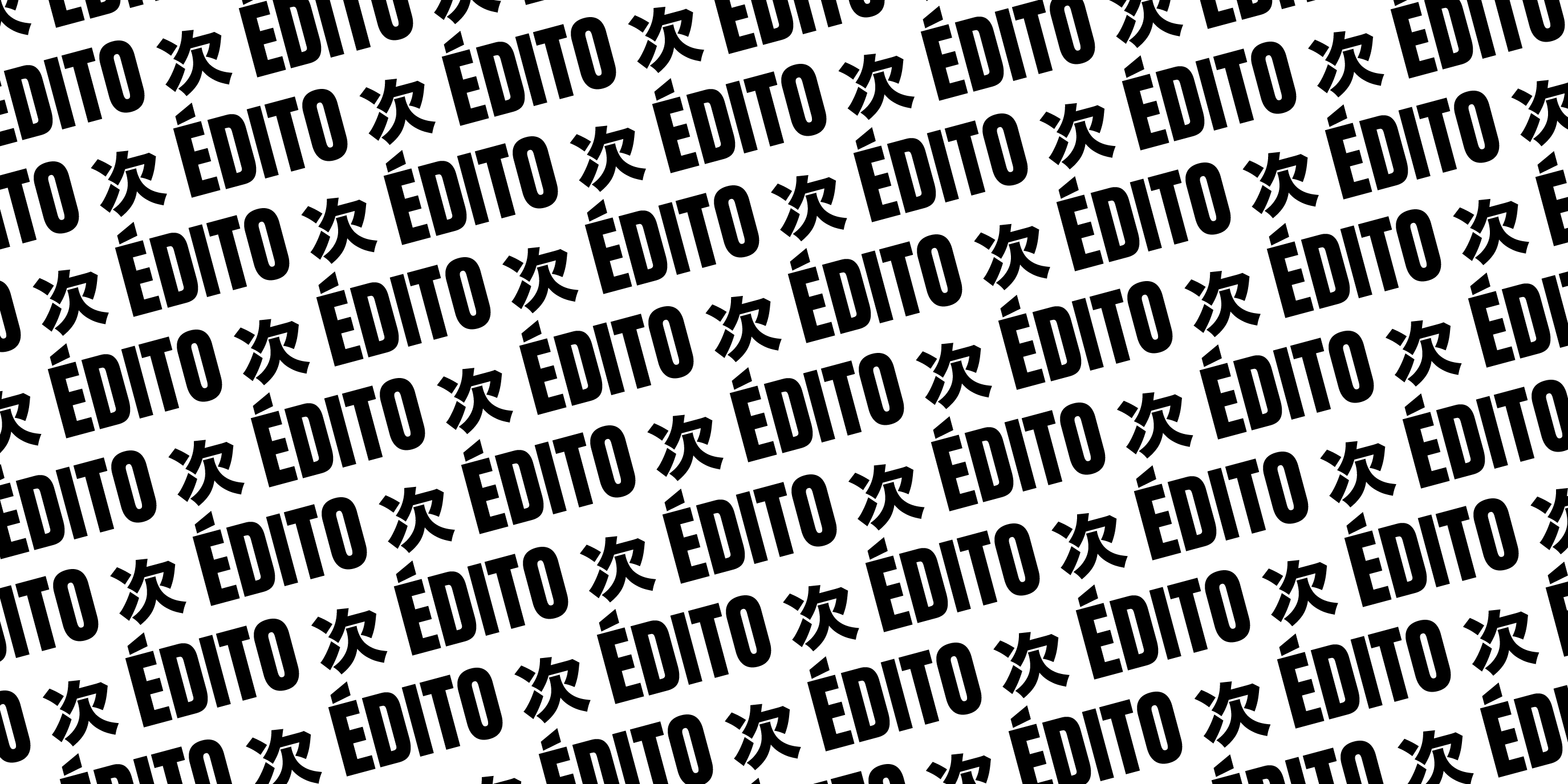Le 23 septembre prochain, les trublion·nes du rock britannique festif de Sports Team sortent leur second album GULP ! En 2020, ils avaient déjà secoué la scène d’outre-Manche avec Deep Down Happy. Un premier opus tinté de sonorités garage américaines, qui leur avait valu d’être nommé au prestigieux Mercury Price. Rencontre avec Alex Rice, chanteur de cette formation un peu à part dans le paysage musical UK.
Petits éléments de contexte pour nos lecteur·trices qui ne vous connaîtraient pas, comment vous êtes-vous rencontrés ?
On s’est tous rencontrés à l’université de Cambridge. Quand les autres étudiant·es sortaient en boîte ou dans les bars, on était toujours terrés, on s’asseyait pour écouter des disques. Très vite, on a réalisé qu’on était le genre de gamins à avoir une guitare accrochée au mur. Tout le monde en connaît. On a commencé à jouer dans des bars pour le plaisir. On disait que c’était une fête afin que ça ne soit pas très cher et que les gens puissent venir. Puis on a déménagé à Londres, on avait des emplois normaux. On s’est lancés très lentement. Et puis, on a rencontré un manager/avocat dans un endroit appelé The Old Blue Last. De là, on a commencé à composer plus de chansons. En fait c’est comme si on était tombé dedans, sans jamais en avoir pris la décision. Soudainement, on était un groupe à plein temps. Je pense qu’on a réalisé que ça devenait sérieux quand on faisait des concerts de plus en plus gros. Parce que tu peux participer à une émission de radio, avoir un article dans la presse, ce n’est jamais aussi tangible que quand tu vois des gens devant toi.
Votre premier album Deep Down Happy est sorti en juin 2020. Je ne sais pas comment c’était au Royaume-Uni mais pour nous, en France, il n’y avait pas vraiment de concerts ou de festivals. Comment l’avez-vous défendu ?
Comme c’était notre premier album et que nous étions un nouveau groupe, nous n’avions pas d’autre choix que de le sortir. C’était prêt. Et on ne s’attendait pas vraiment à ce qu’il ait autant d’écho. Je sais qu’il n’a pas une grande notoriété en France, mais au Royaume-Uni, Deep Down Happy a changé nos vies du jour au lendemain. On a été numéro 2 dans les charts, on a été nommés au Mercury Price. On a alors vraiment détesté le fait de ne pas pouvoir donner de concert. C’était le pire moment. On ne faisait que repousser les dates. On a fini de jouer les dates prévues pendant le COVID qu’en décembre dernier. C’était très bizarre, mais comme nous vivions tous ensemble c’était surement un peu plus facile pour nous que pour les autres. On avait cette maison qui correspondait aux clichés rock’n’roll sombres qu’on peut imaginer. On fêtait la sortie de Deep Down Happy en buvant une bière, sur un banc dans un parc. C’est tout ce qu’on pouvait faire à l’époque. Sortir ce second opus Gulp !, c’est comme si c’était notre première fois. C’est la première fois qu’on a pu faire des concerts chez des disquaires, rencontrer des gens, en parler lors des festivals.
Comment avez-vous vécu ces dernières années en tant que groupe ?
Pas vraiment bien. Je pense qu’on a fait partie des plus chanceux. On a eu la chance d’avoir le soutien d’une grande maison de disque. Il y a la crise du coût de la vie aussi, ce qui est vraiment triste. On remarque que le public vieillit un peu. Les kids ne peuvent plus se payer des billets. La pandémie a encore des répercussions sur la façon dont la musique fonctionne. Mais tu peux aussi ajouter le Brexit à la soupe. Ça a soudainement rendu les tournées en Europe beaucoup, beaucoup plus difficiles. C’est une véritable tempête pour les groupes britanniques. Mais on est encouragé par le fait que la musique semble toujours désirée, on n’a pas l’impression que la demande ait disparu. Il y a une sorte de grande poussée vers l’individu en ce moment et je pense que les gens ont malgré tout toujours ce besoin de transcendance. Quelque chose qui nous sort de notre vie quotidienne, nous donne ce sentiment de communauté. Et je pense que la musique live joue ce rôle. Nos concerts ont toujours voulu être une sorte de moment cathartique pour les gens pendant une heure et demie.
Et j’ai lu que ça a été compliqué pour vous, de trouver votre place dans le renouveau de cette scène rock britannique. Pensez-vous l’avoir trouvée aujourd’hui ?
Oui, c’est vrai. Je pense que le climat dans lequel nous sortons notre disque est vraiment différent de ce qu’il était quand nous avons sorti le premier. Beaucoup de gens faisaient cette musique post-punk inspirée de l’automne. Mais pour moi, quand je rencontrais ces gens, j’avais l’impression qu’ils étaient des poseurs, qu’ils jouaient la comédie. Dès que tu les rencontres en dehors de la scène, ils sont souriants, et prennent une bière avec tout le monde. Je me demandais : « pourquoi faites-vous cette sorte de personnage boudeur quand vous êtes sur scène ? ». Maintenant quand tu regardes des groupes au Royaume-Uni, comme Wet Leg – qui a fait notre première partie à Brixton en décembre – , le groupe Irlandais The Dinner Party ou Courting, on a l’impression de faire partie du bon mouvement. Je pense qu’une grande partie de ce que nous essayons de faire, c’est de parler de sujets vraiment sombres mais de façon à ce qu’à la sortie du concert on se sent mieux dans sa peau. On est entouré de groupes qui font quelque chose qui semble joyeux, grand et grandiose, ils ont l’air heureux d’être sur scène et d’être dans un groupe ensemble. Et je pense que ça a manqué à la musique pendant un certain temps.
Comment avez-vous abordé ce second album ? Aviez-vous peur de décevoir les gens ? Est-ce que vous aviez beaucoup de pression ?
C’était amusant. Mais on avait l’impression d’avoir plus de pression pour celui-ci. Lors de la sortie du premier album, comme on était un groupe inconnu, le label, et nous-mêmes étions plus en mode : « espérons le meilleur, mais voyons ce qui se passe ». Dès que tu as un profil, que tu es établi, tu as soudainement rencontré 20 personnes de plus qui travaillent sur l’album. Je pense qu’il a fallu essayer de garder une vision claire au milieu de tous ces gens réactifs. Pour nous, ça a toujours été la musique live. On a gardé cet objectif sur ce disque, mais je pense qu’il est musicalement plus intéressant. À présent on joue sur des scènes principales, et on ne peut plus jouer du punk rock débraillé. Ça sonne mal et c’est juste très vide. Sur Gulp! on a par exemple un morceau avec des trompettes, on utilise également plus les claviers, comme un groupe multi-instrumentiste. On essaie juste de faire que notre son sonne de manière plus complète quand on est sur ces grandes scènes.
Quelles étaient donc vos influences pour cet album ? Apparemment, vous avez une obsession pour Brian Ferry.
Quand on a écrit Gulp! on a écouté plein de Brian Barry, parce qu’il y a quelque chose chez lui qui nous faisait penser, du moins pour moi, à un monde à part. La façon dont il s’habille et fait cette musique incroyablement glam, ça paraît naturel. Quand tu penses à la « performance », tu ne veux pas voir quelque chose qui a l’air accessible. Tu veux voir quelque chose qui te donne l’impression d’être en dehors de ta vie de tous les jours et ensuite tu te confrontes à celle-ci. Le single « The Drop » (sorti début août, NDLR) est très inspiré par Bryan Ferry. Le sujet est sombre : « Katie est morte en attendant le bon moment pour prendre sa retraite » (paroles ouvrant le morceau, NDLR). Les gens grandissent et ils ne savent jamais vraiment quelle est la bonne chose à faire… et ils attendent et attendent. Avant qu’on ne le sache, tout est parti, on ne profite pas du voyage. C’est une chanson sur ce sentiment. Mais il y a aussi ces sursauts de trompettes qui sont très lumineux.
Y-a-t-il eu d’autres influences ?
En termes de sons de guitare, il y a beaucoup de punk néo-zélandais et australien qui ressort comme Amyl and the Sniffers. Ce qu’ils font en ce moment est génial. Notamment en ce qui concerne la façon dont leurs sons de guitare fonctionnent. Je pense qu’il y a aussi un peu plus de scène pub rock, avec des groupes britanniques comme Eddie & The Hot Rods ou The Dudes.
Tu dis que votre son a un peu changé. Est-ce que par conséquent, quand vous jouez une chanson de votre premier album, cela vous ressemble toujours ?
Le premier album puise dans des expériences très spécifiques de notre enfance. Avec ce second album, on ne pouvait plus prétendre qu’on avait un quotidien normal. Quand on l’a écrit, on a donc essayé d’exploiter des expériences humaines plus larges et l’anxiété, qu’il s’agisse de grandir ou de vivre ensemble. Ou encore comment se sentir accompli dans ce monde, ou comment faire face à une contrariété, quand tu es profondément enfoncé dans le sol, que tu creuses et que tu ne fais qu’empirer les choses. On en parle dans le morceau « Dig ». Je pense qu’en tant que groupe, on a toujours eu pour projet de trouver une façon de vivre dans un monde assez difficile. Thématiquement, cet album est donc assez différent. Mais on aime toujours jouer les morceaux du premier. Je pense que dès qu’on s’en lassera, on arrêtera de le jouer, mais ce n’est pas encore le cas. Pour être honnête, à cause de la pandémie, ça ne fait que six mois qu’on le joue beaucoup. C’est dingue de voir la réaction des kids. Les gens postent tout le temps « Here’s the thing », dès qu’il y a un contexte approprié. Par exemple lorsque que l’équipe féminine britannique de football a gagné l’Euro. Le refrain « lies, lies, lies » est beaucoup utilisé pour tout qui se passe en politique.
Comment avez-vous travaillé sur cet album ? L’avez-vous écrit en tournée ou êtes-vous directement allés en studio ?
Notre guitariste Rob commence toujours à écrire les chansons, il réalise l’ossature puis on travaille dessus. En général, il y a beaucoup de jours de pré-production dans une salle de répétition, pour essayer de trouver des rythmes. C’est ce qui permet de dépasser les limits qu’on se pose en tant que musicien. On obtient un son plus unique. Nous avons donc commencé à écrire Gulp! presque immédiatement après la sortie de notre premier album. Des concerts ont commencé à être annulés assez rapidement à cause du Covid. On a alors trouvé un chalet dans une zone très rurale du Royaume-Uni et on a commencé à travailler pendant deux semaines. Et même là, nous avons été mis à la porte parce que le conseil municipal a dû fermer toutes les propriétés supplémentaires en raison de la pandémie. C’est donc à Bath que nous avons enregistré une grande partie de l’album, avec le même producteur que pour le premier album. Comme on le connaît bien, on pouvait lui envoyer des petits bouts et il pouvait nous faire des retours, du genre : « Je ne suis pas sûr que ça marche, tu vas avoir besoin d’un rythme qui sonne comme ça ». Ça a toujours été un processus très collaboratif. Ce n’est pas un processus d’écriture assis, on ne sort pas des livres pour écrire. On passe plutôt des heures à essayer de trouver la bonne sensation, le bon son ou le bon rythme de batterie. Et puis soudain, tout sonne comme une fête. On essaie de capturer cet état d’esprit : l’excitation d’être avec des gens et de faire de la musique en groupe.
Contrairement à vos paroles, vos mélodies sont toujours joyeuses. Est-ce que vous allez écrire une chansons autant triste dans les paroles que dans la mélodie ?
Je pense que nous essayons de prendre cette direction autant que possible, mais c’est quelque chose qu’il faut apprendre à faire. « Light Industry », qui clôt l’album, est assez triste. Et une chanson comme « Cool it kids » l’est aussi. On a fait appel à Asha de Sorry, pour essayer d’adapter le morceau à sa voix, qui a tellement d’incertitude en elle. Je pense qu’on aimerait un jour écrire une belle chanson, comme « Imagine ». Mais c’est un tel métier de faire de la musique qu’on n’en est pas encore là.
Tu parles beaucoup de tes fans en les appelant kids, quelle est ta perception sur les fans jeunes ? Ils sont souvent décriés dans les médias, notamment les jeunes filles. Sports Team a même un groupe WhatsApp avec ses fans.
Pour nous c’est super important d’avoir des fans jeunes. Ils sont ouverts à plein de genres musicaux. C’est marrant, parce qu’on on a vu beaucoup de nos fans grandir depuis les premiers concerts. Ils venaient quand ils avaient peut-être 16 ans et maintenant ils ont 21 ans et font des choses incroyables. Je pense que nous les trouvons aussi inspirants qu’eux nous trouvent inspirants… enfin je l’espère. Et puis selon moi, la relation avec les fans a évolué. Ce n’est plus pareil qu’il y a dix ou vingt ans avec les groupies, et où le groupe avait l’ascendant. C’était sordide. Les groupes ne vendent plus des millions de disques dans le monde. On compte maintenant sur les gens pour nous soutenir, nous guider et nous aider à tenir le coup. C’est devenu une sorte de relation à double sens. Donc ouais, avoir un groupe WhatsApp avec eux semble vraiment naturel. Dans quelques semaines, nous organisons un voyage en bus à Margate, où vit la moitié du groupe. Comme aucun de nous n’a grandi à Londres, on a toujours voulu que les gens puissent venir à nos concerts sans avoir à dépenser de l’argent dans le train pour s’y rendre. Alors on a mis en place des bus qui vont là-bas et emmènent les gens. C’est un concert gratuit. On essaye de faire beaucoup de choses comme ça.
Et avez-vous prévu de jouer en France bientôt ?
Oui. Je crois que Paris est la dernière date de notre tournée européenne. On est tellement excités ! On a beaucoup d’amis à Paris et on a passé de chouettes soirées là-bas dans les bars. Donc ouais, je suis impatient. Dernière date, the big one.
Sports Team jouera le 21 novembre à la Boule Noire à Paris.