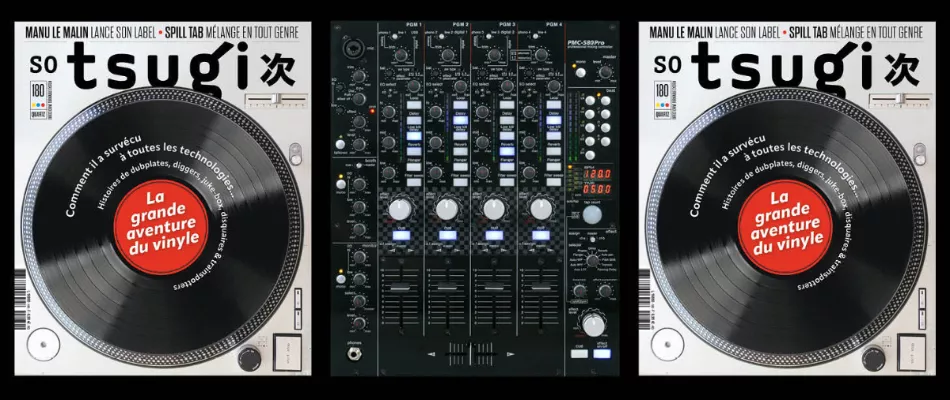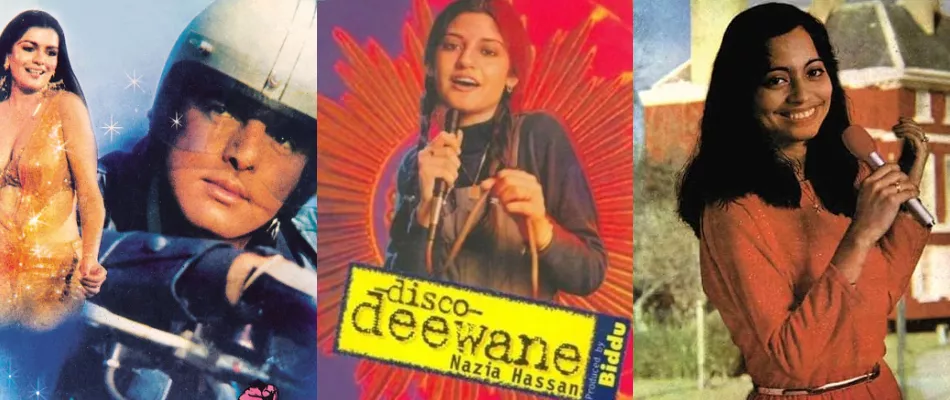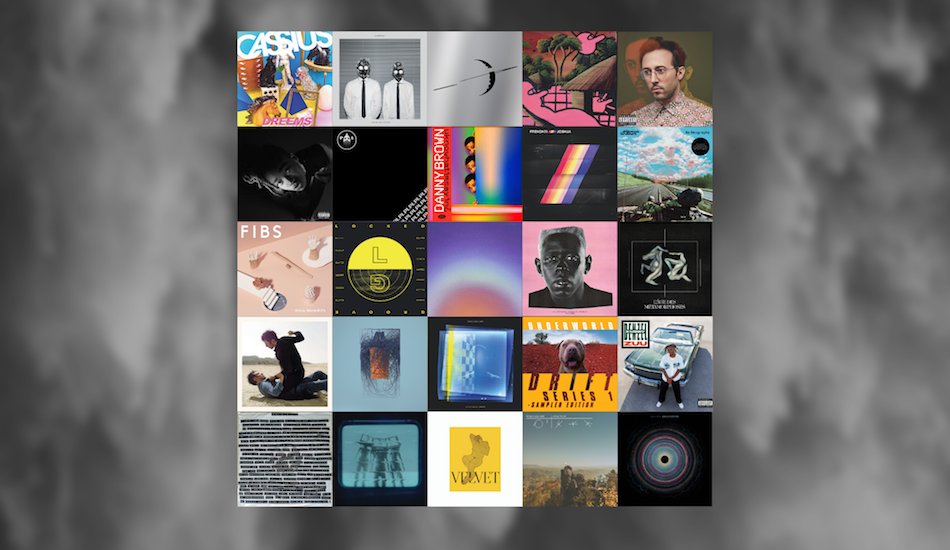À l’origine, c’était un pseudonyme de secours. Trouvé la tête en l’air au croisement de la rue St Jacques et l’avenue Greene, l’alias servait uniquement à obtenir un retour objectif de ses amis quant à ses expérimentations musicales. Alors producteur de hip-hop électronique et officiant dans les soirées montréalaises Turbo Crunk derrière son alias Hovatron, c’est finalement dans une musique personnelle, entre techno anglaise et house onirique que Philippe Aubin-Dionne a fini par tirer son épingle du jeu, sous le nom de Jacques Greene, donc. Après huit ans de carrière et un premier album sorti l’an passé, il nous parle ici d’un nouveau double EP comme un digestif avant de renchainer sur un nouveau long format, de la conception de sa musique, de sa conception de la musique, et de ses inspirations.
En sortant Feel Infinite, tu as beaucoup parlé de la difficulté pour toi de produire un premier album cohérent, sur un format plus conséquent qu’à ton habitude. Avec Fever Focus, tu reviens avec le plus long EP que tu aies présenté à ce jour. Alors, on prend goût à la durée ?
Jacques Greene : C’est exactement ce qu’il s’est passé. Faire un album était avant tout un challenge. Davantage prendre son temps, s’étendre, et garder une cohérence. J’aime beaucoup le format quatre tracks, mais il faut vraiment que chacun soit un morceau à part entière, alors qu’il peut y avoir des tracks plus «secondaires» dans un album. Je ne voulais pas non plus sortir un deuxième album juste après le précédent, histoire de ne pas saturer le marché (rires). J’admire les rappeurs qui sortent des mixtapes tous les mois, mais je n’ai pas besoin de faire ça.
Ce nouvel EP est divisé en deux parties, et donc deux disques. Peux-tu nous expliquer sa conception ?
C’est d’abord par fonctionnalisme. Je joue du vinyle en club, et quand tu presses six morceaux sur un même disque, le son peut perdre en qualité. Après, j’ai travaillé avec un illustrateur que j’adore, Bráulio Amado,et on a vraiment commencé à tripper. On s’est retrouvé à penser le truc au delà de la question pratique. Deux couleurs différentes, pour exprimer une espèce de dualité. La première partie est vraiment plus éloquente. La deuxième est plus calme.
En bientôt dix ans de carrière, tu as toujours gardé un son en dehors des tendances. Une empreinte house très UK garage, parfois 2-step, breakée, avec des choses très mélodiques et beaucoup de vocaux et samples R’n’B. J’ai l’impression que ton son n’a que peu évolué, et surtout qu’il ne vieillit pas. Comment tu fais ?
Disons plutôt que ça fait environ huit ans que je suis dans cette carrière. Dix ans, ça fout une claque… (rires) La plupart des trucs que j’aime viennent des gens ou des choses qui ont une identité tellement forte qu’ils ne peuvent s’en affranchir. Quand David Byrne lance des projets avec Brian Eno, ça sonne quand même David Byrne. Pareil pour le créateur et styliste Rick Owens, ça fait 21 ans qu’il a sa marque, quand il sort un truc, c’est du Rick Owens. J’aime les gens qui savent qui ils sont. Je pense et j’espère que quand tu compares mes premiers projets avec ce que je fais aujourd’hui, il y a quand même eu une maturation. Un son peut-être un peu plus élégant, mais je suis qui je suis et quand je suis en studio, je fais attention de ne pas me perdre dans une tendance. Souvent je me dis «ça pourrait être intéressant d’aller tester des trucs plus electro, ou des édits disco», mais je me dis aussi «est-ce que c’est vraiment moi, est-ce que c’est ce que je veux ?»
Tu t’imposes volontairement des contraintes dans ta musique ?
Tout le temps ! J’ai tellement envie de choses différentes, parfois je me retrouve à faire de l’ambient pendant deux semaines par exemple, donc ce n’est pas uniquement par rapport à la tendance. Il me faudrait des side projects… Pour moi, Jacques Greene c’est un son et un monde. À chaque sortie, c’est un peu «si t’as bien aimé le précédent, écoute celui ci, mais si t’as pas aimé, t’aimeras surement pas le prochain non plus». (rires) J’espère juste que je me ne répète pas trop, qu’on ne se dise pas «je sais pas si c’est sorti en 2012 ou en 2018», mais en même temps je fais exprès de garder cette ligne directrice très définie.
Ta musique est très associable à la scène UK, mais tu es Canadien. Comment en es-tu arrivé à ce son ?
Je suis venu à la musique électronique par Aphex Twin, Boards of Canada, des noms anglais et écossais. Mon éducation électro s’est davantage faite par ces gens là que par MSTRKRFT ou Tiga. Mes premiers amours musicaux étaient anglais, et c’est ce que j’écoutais quand j’ai commencé à composer mes premiers morceaux. Les débuts du dubstep, Horsepower Productions, Rinse FM… Ça ne m’a jamais quitté.
De ton propre aveu, Montreal est très française. C’est une ville quasi-européenne que tu dis préférer à Toronto, pourtant, c’est là que tu vis. Pourquoi ?
Je suis parti de Montréal pour habiter à New York pendant trois ans. J’ai adoré ça, mais trois ans, ça m’a suffit. C’est un rythme un peu malsain, c’était cool mais il était sûrement temps de ralentir. En revanche, remonter à Montréal signifiait un peu un retour à la case départ. Une forme d’échec dans un sens. Du coup, comme Toronto est la plus grande ville du Canada, ça fait un peu comme un entre-deux. Je savais que je voulais partir de New York parce qu’aux États-Unis, je commençais à ressentir un environnement politique et social qui ne me plaisait pas trop… On sentait l’agression, l’anxiété, et comme je ne suis pas citoyen américain, c’était très particulier. Payer mes taxes au Canada et avoir mon assurance maladie me tentait plus que me plonger dans l’atmosphère américaine qu’on peut voir aujourd’hui.
Comment vois-tu la scène électronique nord-américaine aujourd’hui ?
Pendant quelques années, il y a eu des gens comme moi, comme Motor City Drum Ensemble, comme Four Tet, des sons un peu plus «de gauche», un peu plus underground, qui ont trouvé un public sur place. Mais depuis un an ou deux, il y a un regain d’engouement pour l’EDM, et une fermeture vers les musiques que je considère comme étant plus intéressantes. Au sein de la scène EDM, il y a un coté un peu totalitaire dans la façon dont les gros festivals EDM sont présentés. J’associe tout ça à quelque chose très à droite. Gros clubs, immenses scènes et énormes sonos qui pendent de la gigantesque structure. Et tout ce truc qui te balance de la soupe à la gueule… En dehors des comparaisons politiques, je me sens en marge de cette scène, et cette marge est de moins en moins représentée aux États-Unis et au Canada. Mais ça me va, on se retrouve davantage dans des warehouses, des environnements plus personnels, c’est tout aussi intéressant. À New York ou Los Angeles par exemple, c’est toujours dans les warehouses que ça se passe. On se retrouve dans le profond Brooklyn, vers Bushwick ou Greenpoint, car il n’y a rien à Manhattan. Même Four Tet ne jouerait plus là bas par exemple. À Los Angeles, il y a une belle scène de hangars et d’entrepôts. À Chicago ou San Francisco, il y a des belles salles, mais c’est pas évident non plus de les investir. Puis au Canada en dehors de Vancouver ou Calgary, beaucoup de salles ferment. Même à Toronto…
Ce n’est pas un secret, tu es un grand fan de hip hop et de rap. Qu’est-ce qui te retient de faire des prods en ce sens ?
Je suis tellement fan de hip-hop, que je crois que c’est pas mon rôle de m’y introduire. À mon sens, ce serait presque une appropriation culturelle. La position de fan m’est plus confortable. Par exemple, Young Thug est l’un des mecs les plus créatifs du moment, mais est-ce que j’ai vraiment envie ou besoin de voir Young Thug produit par Jacques Greene ? Non ! Pourtant, si jamais ça se faisait du manière naturelle et honnête, mon Dieu que j’aimerais ça ! Je tâte toujours un peu le terrain, je mets l’orteil dans l’eau de temps en temps… J’ai fait quelques collaborations avec Clams Casino, un producteur de hip-hop avec qui je communique régulièrement. On s’envoie des trucs entre nous, parfois même à d’autres personnes, mais pour l’instant ça en reste là. Je ne dis pas non, mais j’attends que ça se fasse naturellement. Le petit Canadien blanc qui fait de la house et de la techno, et qui se retrouve à composer pour des rappeurs dans le cadre de la grosse industrie, c’est loin d’être un produit culturel qui m’intéresse.
Aujourd’hui Jacques Greene c’est un nom qu’on connait, mais avant ça tu avais sorti quelques morceaux sous le pseudo Hovatron, où tu faisais justement des instrus hip hop un peu folles pour l’époque. Pourquoi ne pas avoir continué ?
Hovatron, c’était quand je finissais mon secondaire (équivalent du lycée au Canada ndr). Je devais avoir 18 ans, et j’avais une résidence avec Lunice et Megasoid pour ne citer qu’eux. C’était assez expérimental, on faisait des beats rap orientés électronique, inspirés par Modeselektor, Para One ou Flying Lotus… C’est aussi à ce moment-là que j’ai découvert la techno et la house. Et puis, Lunice était tellement meilleur que moi là-dedans que je lui ai laissé la place… «Allé, vas-y, c’est pour toi !». Après ça, j’ai commencé à faire la musique de Jacques Greene de mon coté, puis Mary Anne Hobbs s’est mise à la jouer sur la BBC Radio 6. J’ai vraiment trouvé mon truc-là dedans. C’est arrivé à l’époque de l’éclosion de Kaytranada, c’est peut-être aussi pour ça que je me suis mis en retrait…
Et pour toi, c’est quoi la suite ?
J’ai commencé à travailler sur un nouvel album, pour lequel je veux me focaliser sur une palette sonore vraiment identifiable. Un peu à la manière du Silent Shout de The Knife. C’était tellement défini que j’ai eu envie de ça, produire un disque très contextualisé, clair et précis. Un univers spécifique et entier. J’ai commencé cet été. On peut voir Fever Focus comme un rince bouche, avant de repartir sur un nouvel album. Si tout se passe comme prévu, ce sera pour l’année prochaine.
L’EP est en écoute ci-dessous, et disponible ici.