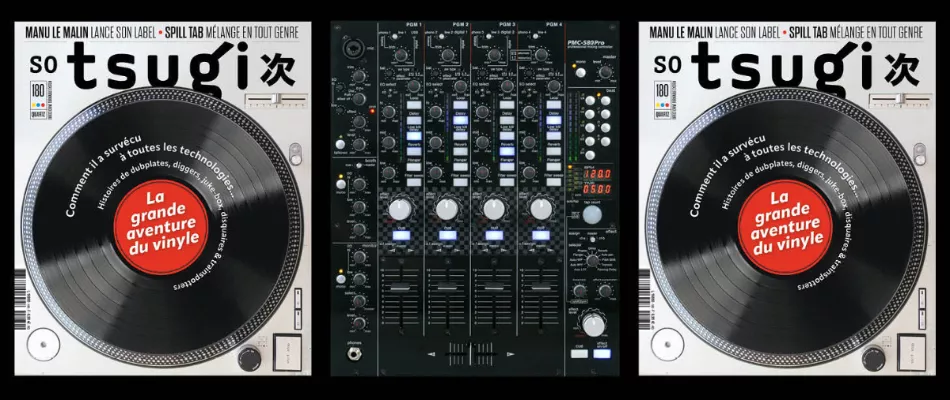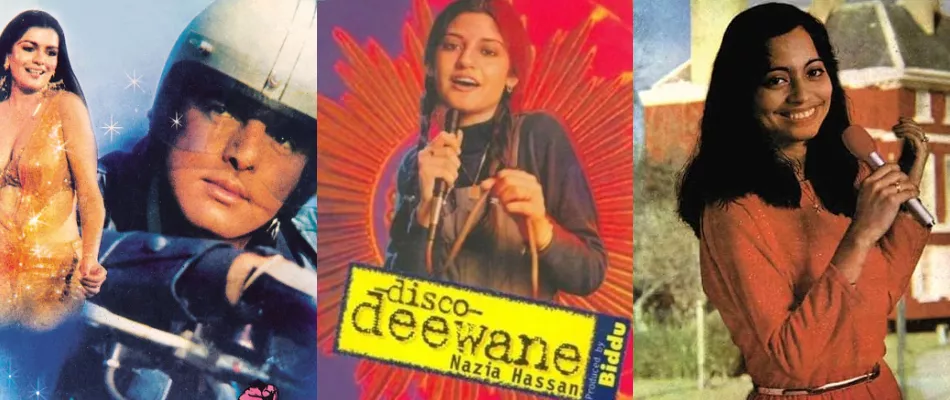Cette semaine, Tsugi vous invite à lire ou relire cinq articles de la série consacrée aux pop stars, initialement publiée dans le zine bordelais Le Gospel (le #6 se chope ici). Aujourd’hui, nous réécoutons l’album Nightclubbing de Grace Jones, sorti en 1981 qui fit la transition entre disco, soul, new wave, art rock et synth pop. Rien que ça.
Par Adrien Durand
“Findeclaire”

En lisant l’“hospitality rider” d’un artiste, on en apprend souvent beaucoup plus que dans n’importe quel communiqué de presse ou article complice du jeu de la promo. Celui de Grace Jones, publié récemment, est assez instructif à bien des égards. Passées les traditionnelles bouteilles de vin français que ni vous ni moi ne pouvons nous offrir, on découvre que la chanteuse demandait deux douzaines de “findeclaire” (sic) et un couteau car “Grace ouvre elle même ses huîtres”. Si cette femme de goût n’avait peut-être pas forcément envie qu’un régisseur mette ses doigts dans ses précieuses coquilles (ce que je peux tout à fait comprendre), il y a quand même dans cette micro-anecdote une notion forte : Grace Jones était une artiste indépendante (pas au sens business du terme) qui continuait d’affirmer une volonté de fer par une poigne qui ne l’était pas moins. Même en baignant dans un luxe somme toute bien mérité.
Il faut tout de même noter que la chanteuse se trimballe une image de guerrière depuis la fin des années 1970, la presse la désignant régulièrement comme une valkyrie, une amazone et (malheureusement) aussi une diva. Soit tout un lexique caricatural qu’on accole généralement aux femmes libres et échappant au cliché de la gentille épouse soumise ou de la bimbo ultra sexualisée un peu bête (l’assistante du magicien). Quoiqu’il en soit, une chose est sûre: Grace Jones n’avait besoin de personne pour ouvrir ses huîtres.
Autodafé disco
Quand Grace Jones sort Nightclubbing en 1981, deux époques se chevauchent. L’hédonisme des années disco a succédé aux utopies hippies mais pas pour longtemps. La disco demolition night du 12 juillet 1979 est une mise en scène spectaculaire de la mort du disco, lors d’un match de baseball entre les White Sox de Chicago et les Tigers de Detroit. Si ce sont seulement des disques qui y sont brûlés, cet événement est bien souvent considéré comme l’exécution publique d’un genre et des communautés qui y sont associées. Alors que quelques mois auparavant, Arthur Russell (aidé dans l’ombre par Julius Eastmann) sort l’hymne ultrasexuelle Go Bang (sous l’alias Dinosaur L), les maisons de disques prennent leurs distances avec le disco. Et nombreux sont les observateurs de l’époque (Nile Rodgers en tête) à interpréter cette autodafé comme une démarche de nettoyage ethnique de la musique des 70’s (un spectateur qui était dans le stade a raconté à NPR que les spectateurs brûlaient pêle-mêle les disques d’artistes afro-américains, disco ou non).
Le début des années 1980 est marqué par l’avènement de la new wave et Nightclubbing est clairement une incursion sur les territoires esthétiques de cette musique taillée pour les classes moyennes blanches. Ce disque n’est pourtant pas un exercice de style. Il est un digest extrêmement réussi de dance music, rock, disco et soul avec une production soyeuse qui sonne encore aujourd’hui totalement crédible. Et c’est entre autres pour ça qu’il est un “instant classic”, comme on dirait sur VH1. Explications…
« Tu cherches quoi ? À rencontrer la mort ?”
Pour enregistrer son cinquième album, Grace Jones embarque aux côtés de Chris Blackwell (le président d’Island) pour le mythique Compass Point Studios de Nassau aux Bahamas. Enregistrer un album nocturne sur une île au soleil brûlant ? Une idée un peu saugrenue mais qui avec le recul a contribué fortement à la réussite et la singularité de ces enregistrements. Soutenus par la section rythmique formée par Sly & Robbie (qui ont joué avec à peu près tout le monde, de Gainsbourg à Dylan), les morceaux du disque bénéficient d’une rondeur exceptionnelle que seul un héritage dub pouvait garantir (et qui a toute sa place chez la chanteuse jamaïcaine).
Nightclubbing est un disque qui (plus ou moins volontairement) efface les gimmicks de styles et donne un exemple d’une musique de danse qui s’écoute aussi à la maison. Et qui contient effectivement tous les sentiments et humeurs par lesquels passent le « nightclubber », de la tombée de la nuit au lever du jour. C’est un cas d’école qui inspirera des générations de musiciens, de MIA à LCD Soundsystem. Et qui nous transforme en petite souris invitée dans des fêtes flamboyantes où l’on aurait jamais espéré être convié. On découvre à cette occasion aussi la saleté derrière les paillettes, l’odeur du cuir et le champagne sans bulles. La fête triste. Pour la première fois. Grace Jones trimballe avec elle tout le folklore des nuits new yorkaises de la fin des années 1970, celui du Studio 54 en particulier. Archétype de la créature nocturne, elle va faire de ce disque une œuvre profonde et narrative, un pied dans l’histoire de la musique, l’autre dans son journal intime.
On retrouve sur Nightclubbing trois reprises, qui, savamment choisies et ré-interprétées, racontent entre les lignes l’état d’esprit de l’artiste à l’époque. Il y a bien évidemment le morceau titre emprunté à Iggy Pop & David Bowie, copains de soirées (on l’imagine), déjà une œuvre de passage et de transition pour les deux drug buddies transformée ici en dub minimal. Use Me, emprunté à Bill Withers et qui offre à l’héritage soul un écrin futuriste et synthétique. Et enfin I’ve Seen That Face Before (Libertango), basé sur un morceau traditionnel de Astor Piazzolla et qui comporte opportunément un passage en français (écho idéal au succès de sa reprise de « La vie en rose » de Piaf). Un morceau ultra cinématographique (immortalisé par Frantic de Polanski) qui projette des images de danger et de sex appeal dans la tête des adolescents du monde entier. Les morceaux écrits par Jones elle-même ne sont pas en reste (le robotique Art groupie, comme un Devo SM ou Pull Up the Bumper, ultra tube dance punk avant l’heure). Sur Demolition Man, écrit par Sting, elle se permet même une petite incursion politique et met clairement à l’amende la version enregistrée quelque mois plus tard par The Police. En 1981, le ciel bleu des Bahamas est la seule limite pour la chanteuse.
En 2015, Grace Jones, après une carrière relativement impeccable (et avoir traumatisé quelques enfants dont votre serviteur dans Conan le Barbare face à Schwarzie), publie une autobiographie, adroitement intitulée I’ll never write my memoirs. Elle s’y dévoile enfin davantage, évoquant notamment sa relation avec son père pasteur et sa rébellion adolescente qui passa par (je vous le donne en mille) la fréquentation des night-clubs new-yorkais. Elle y déglingue dans les règles de l’art toute une génération de nouvelles chanteuses et célébrités qui se réclament à visage plus ou moins découvert de son héritage. En pleine promo pour la sortie du livre, elle confiait aux Inrocks :
« Bien sûr que j’aime Rihanna, elle a une super voix mais je pense qu’elle devrait suivre sa propre voie et ne pas faire comme moi en imitant mes coupes de cheveux ou en se faisant peindre tout le corps comme je l’avais fait avec Keith Haring. J’ai découvert que l’idée ne venait pas d’elle mais d’un styliste qui aimait notre travail. »

Pas décidée à être réduite au statut d’épingle sur un moodboard Pinterest, Grace Jones a de quoi avoir les glandes. Quand Kim Kardashian reproduit une photographie iconique avec le même photographe (Jean-Paul Goude, responsable aussi de l’identité visuelle de Nightclubbing et de bien d’autres choses chez Jones) et qu’elle “casse Internet”, c’est tout un schéma d’innovation qui s’écroule dans un nuage de viralité. Grace Jones incarne pourtant un dépassement rare de la figure de la pop star (ou au moins une remise en cause). Insoumise aux canons de son époque et hors formats, pionnière d’une certaine forme d’empowerment, plutôt rare dans la pop culture d’alors, elle est aussi derrière des disques charnières de la musique moderne, qu’on réécoutera probablement encore dans quelques décennies, des images d’ivresse, d’éclats de rire, de caresses et de coups de martinets plein la tête.
❏
L’article original a été publié sur Le Gospelici. Le zine #6 est disponible par là.
À lire dans cette série :