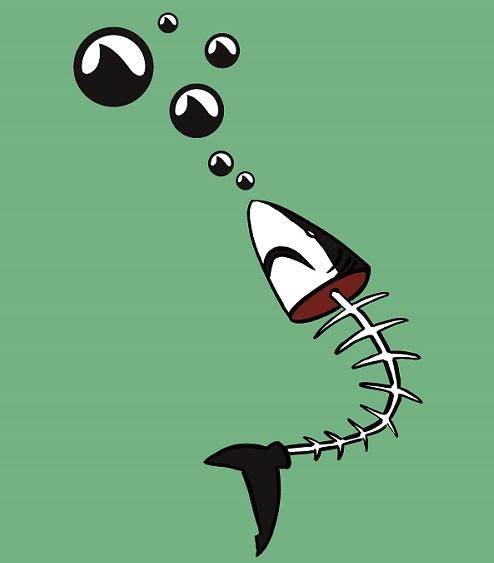Comment les majors ont eu la peau de Grooveshark
Grooveshark était gratuit. Grooveshark, c’est fini. Lancée en 2007, la plateforme de streaming n’aura pas résisté aux assauts répétés de l’industrie musicale.

“Chers fans de musique, aujourd’hui nous fermons Grooveshark.” 30 avril 2015, l’annonce est brutale : Grooveshark, c’est fini. “Chers fans de musique”, pour toute réclamation, adressez-vous aux majors. Qui ont réussi à fermer le service de streaming en échange de l’effacement d’une gigantesque ardoise. Il faut dire que ça leur pendait au nez. Malgré son récent ravalement de façade, Grooveshark naviguait en eaux troubles depuis quelque temps déjà. “Depuis le début, en fait”, corrige Steve Gordon, avocat américain spécialiste en droit de la musique et auteur du livre Le Futur du business de la musique. Considéré comme un service pirate par les majors, le vilain petit canard du streaming avait été également blacklisté par Google, Apple et Facebook : le premier en le supprimant des suggestions de son moteur de recherche, les suivants en supprimant l’appli de leurs plateformes. Le 30 septembre 2014, les choses deviennent sérieuses : Escape Media, la société qui gère Grooveshark, vient de perdre en première instance sa bataille judiciaire débutée en 2011 par trois grandes compagnies de disques – Sony, Warner et Universal. Condamnée pour violation de droits d’auteur, la compagnie encourt une peine de plusieurs centaines de millions de dollars (736 millions, estiment les observateurs). Le 27 avril devait se tenir l’audience qui déterminerait définitivement ce montant.
Une raclée symbolique ?
L’audience n’aura finalement pas lieu. Après avoir envisagé de faire appel, les fondateurs de Grooveshark rendent les armes et signent un accord avec les majors : la compagnie devra fermer ses portes, s’acquitter de 50 millions de dollars, publier des excuses publiques (probablement âprement négociées par les avocats, à lire la teneur du mea culpa), et transférer la propriété de leur site, leur appli mobile et leur propriété intellectuelle, “y compris les brevets et droits d’auteur”. Une peine sévère, publique (elle est affichée en page d’accueil de feu Grooveshark) et… symbolique, nous explique Steve Gordon. “Je ne crois pas que Grooveshark soit connu pour quoi que ce soit d’innovant ou ait une quelconque propriété intellectuelle, lance-t-il. Les maisons de disques ne vont rien faire de Grooveshark, ils n’en ont pas besoin.” Quant à savoir si la compagnie possède 50 millions de dollars, c’est une autre histoire. Elle avait tout de même récolté une mine de données sur ses utilisateurs pour son service Beluga, lancé en 2012, un moteur de recherche librement accessible qui permettait de rechercher le profil des fans pour un artiste donné. La compagnie avait ainsi soumis ses utilisateurs à une enquête poussée sur leurs habitudes socioculturelles : leur matériel hi-fi, leurs habitudes de navigation et de consommation culturelle, etc. Si nombre d’observateurs s’interrogeaient à l’époque sur la fiabilité de ces données déclaratives, il y a fort à parier qu’à l’ère du big data, les maisons de disques ne les balaieront pas d’un revers de manche.

Mais comment Grooveshark a fait pour tenir jusque-là ? Pas de pub audio ou presque, un catalogue immense (environ 15 millions de morceaux), 35 millions d’utilisateurs mensuels revendiqués (à titre de comparaison, Spotify en revendique 60 millions) et un service gratuit sans limitation, dans le paysage encombré du streaming, Grooveshark faisait figure d’exception. Son secret : contrairement aux autres services, ce sont les utilisateurs qui chargeaient les morceaux hébergés sur la plateforme (comme sur YouTube, par exemple). Selon les fondateurs, ils n’étaient donc pas responsables des violations de droits d’auteur mais seulement de supprimer les contenus signalés comme tels, en vertu du “safe harbor” (sphère de sécurité, refuge), prévu par le Digital Millennium Copyright Act, la loi américaine de référence en matière de téléchargement illégal. Voilà pour le discours officiel. Dans la réalité, Samuel Tarantino et Joshua Greenberg, fondateurs et dirigeants de la compagnie, n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour remplir le catalogue – et à encourager activement leurs employés à faire de même (sous peine de se retrouver sur la “shit list officielle”, écrivait en 2007 Greenberg dans un mail à ses employés). Un excès de zèle qui les sort d’office de la protection du “safe harbor”. En tout, c’est plus de 5977 fichiers qui ont été ainsi uploadés à l’initiative de la compagnie, dont 4907 ont été retenus pour le calcul des dommages et intérêts (près de 135 000 euros pour chaque fichier illégalement chargé). Pour couvrir leurs traces, les dirigeants ont également effacé une partie de leur base de données, ont conclu les juges.
En guise de lot de consolation
Grooveshark était-il pour autant immoral ? Chacun se fera son idée. Il est vrai que la compagnie n’avait pas pu (ou voulu) trouver d’accord avec les majors (il faut dire que ces fameux accords sont particulièrement coûteux, comme l’a récemment révélé la fuite du contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars entre Sony et Spotify). Leur seule tentative, un contrat passé avec EMI, s’est soldée par trois procédures judiciaires, dont la dernière emportée par la major en avril dernier. Grooveshark avait cependant trouvé un terrain d’entente avec certains labels indépendants. En 2012, rapportait Libération, Steven Corn, de BFM Digital (qui représente et défend les intérêts d’artistes indépendants), tentait ainsi de défendre la plateforme :“Mes artistes sont payés par Grooveshark. Ceci parce que nous avons passé un accord avec eux. Il n’y a pas beaucoup d’argent en jeu pour les artistes, mais on peut dire la même chose pour beaucoup de services de streaming, y compris Pandora, Spotify, etc. En fait, je reçois plus d’argent de Grooveshark que d’autres services plus acceptables comme Last.fm ou We7.”

Pour les maisons de disques, c’est une victoire certaine contre Grooveshark. Mais la question du “safe harbor”, une épine dans le pied de l’industrie, reste ouverte. De son côté, Grooveshark tente de renaître de ses cendres et une myriade de sites apparaissent sous des extensions différentes (grooveshark.io, .li, .cf). Dans une lettre envoyée au site Digital Music News, un anonyme qui se présente comme un ancien employé de la compagnie et comme l’instigateur de ces clones adresse un message à l’industrie : “GROOVESHARK NE MOURRA JAMAIS.” En attendant de voir réapparaître un service de streaming libre et à la limite de la légalité, les fans déçus pourront toujours se consoler en récupérant leurs playlists (en format texte) sur googleglass.my/groovebackup/. Salut Grooveshark, et encore merci pour le poisson.