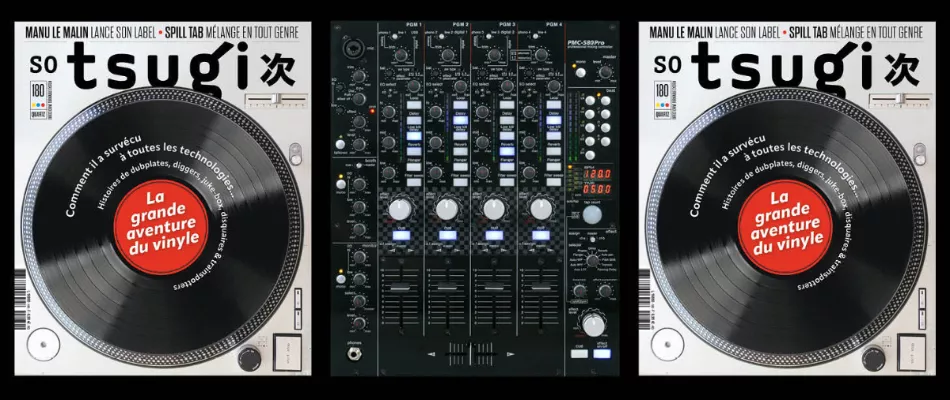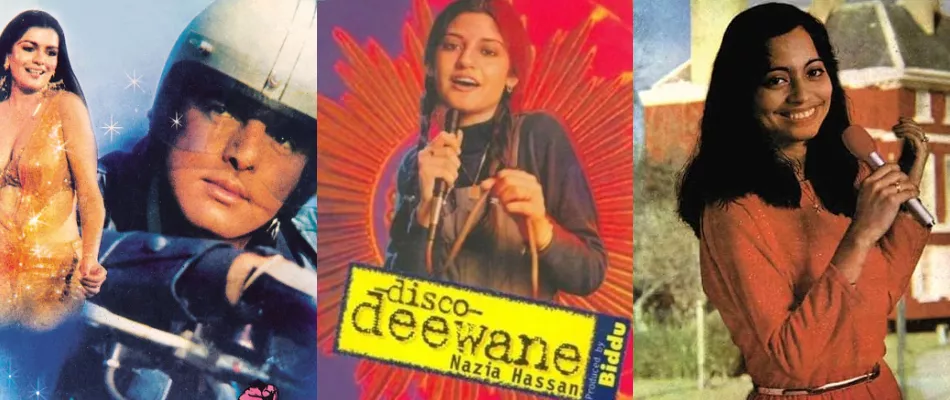Des coûts réduits, un seul salarié patron à tout faire, du flair et beaucoup de passion. Depuis 2006, Born Bad Records a remis le punk et le garage-rock à l’honneur et les a rendus économiquement viables.
Quand il se lève dans sa maison de Romainville en banlieue parisienne, c’est en répondant aux mails venus des quatre coins du monde pour son label Born Bad Records que Jean-Baptiste Guillot entame sa journée. “C’est amusant le décalage entre la vision que les gens ont de toi et la réalité de ton métier. Ma vie, c’est relever mes messages…” Devenu un véritable couteau suisse du rock’n’roll indie, il en fut aussi l’homme qui tombe à pic. En 2006, il lance le label pile au moment où l’industrie du disque commence à battre de l’aile. Il se plie alors à une redéfinition en règle du métier en revoyant d’emblée ses coûts à la baisse, prenant lui-même en charge la quasi-intégralité des fonctions, de la relation avec ses groupes à l’ensemble de la supervision de la chaîne : fabrication, envoi des commandes de disques, contrats, rémunération des artistes, booking de leurs concerts quand ils n’ont pas encore d’agent…
Le choc de simplification
En travaillant à son domicile transformé en bureau et en stock pour ses CD’s et vinyles, il a commencé par supprimer les charges de loyer du label. Autrefois salarié d’une major du disque, il en a gravi tous les étages en démarrant comme grouillot affecté à la machine à café pour finir directeur artistique des éditions. “Je devenais amer et aigri car je découvrais un monde qui n’était pas à la hauteur de mon idéal du travail dans la musique.” Il investit 10 000 euros de ses indemnités de départ dans la création d’une SARL. “J’ai pris comme modèle des noms comme New Rose et Rough Trade qui associaient un label à un magasin de disques qui lui offrait une vitrine physique.” Son projet de label emballe immédiatement Born Bad, disquaire qui sévit dans le garage-rock et le punk depuis 2002 dans le XIe arrondissement de Paris. “Mon atout, c’est d’avoir évolué depuis l’adolescence dans les circuits alternatifs. Je connaissais tout des codes du ‘do it yourself’, du rock’n’roll et de cette scène dont j’étais déjà un acteur à travers l’organisation de concerts. C’est plus mon passage en major qui avait été une anomalie mais j’y ai acquis une technicité, un savoir-faire, un réseau de connaissances ainsi qu’une vision globale du métier qui m’ont permis de démarrer très vite. J’étais efficace car je pouvais réunir toutes les compétences qui sont là-bas réparties sur plusieurs personnes.” Il signe alors ses premiers succès : l’album de Frustration, bêtes de scène dans une veine post-punk à la The Fall et Wire au public fidèle. Puis BIPP, une compilation de pépites de la new wave synthétique hexagonale période 1979/1985. “J’ai entendu plein de railleries à l’époque à propos de ces boîtes à rythmes cheap. Aujourd’hui, tout le monde écoute ça…” Il élargit son catalogue, piochant à Paris et en province : Cheveu, The Magnetix (Bordeaux), Jack Of Heart (Perpignan), Wall Of Death (Paris), The Feeling Of Love (Metz)… soit toute une horde d’outsiders qu’il extirpe des réseaux souterrains garage-rock et punk en les rendant hype auprès d’autres publics grâce à ses relations dans l’électro, son flair et son ouverture d’esprit.
Son catalogue grossissant, il doit bien s’obliger à une professionnalisation des rapports avec les groupes. “Au début je fonctionnais sans contrats… C’est lourd et ça me dérangeait d’amener du juridique dans des relations avec des gens tellement loin de ça. À partir de la troisième année, c’est devenu indispensable d’en mettre en place, pour ma société comme pour les artistes.” Là encore, il innove en réduisant la paperasse. “J’ai rédigé des contrats standard d’un minimum de pages. Les artistes ne sont liés que pour un disque, ce serait ridicule de les forcer à rester. D’ailleurs, certains ont été sollicités par des majors mais sont restés.” Sur le fond, ses contrats visent aussi la simplification. “Aucun label indé, moi le premier, n’est capable de réaliser un décompte des royautés.” L’artiste est ainsi payé en pourcentage des disques fabriqués. “Les groupes y trouvent leur intérêt en gagnant plus et moi, ça me simplifie la vie. Avec quinze artistes je ne peux pas faire autrement.”
Des prix abordables
Après avoir passé des mois à harceler les disquaires pour qu’ils mettent en vente ses sorties, le poids acquis lui permet d’opter pour un gros distributeur qu’il a remplacé l’an dernier par un plus petit basé en province. Pour l’export, il travaille avec quelques distributeurs étrangers et en direct avec des disquaires grâce au réseau de la boutique Born Bad.
Dernier secret de la réussite, sa politique de prix agressive sur les CD’s et les vinyles. “C’est quand même dingue que le vinyle soit redevenu un produit de luxe… les miens sont abordables, moins chers qu’une pizza.” Avec une fourchette de prix oscillant entre 10 et 15 euros l’album, Born Bad peut se vanter de francs succès : 10 000 exemplaires vendus pour le dernier Frustration, 8 000 pour Cheveu, 3 000 pour Feeling Of Love… artistes dont le label gère également les éditions du répertoire. Il se fait aussi plaisir à travers un travail d’exhumation sur des compilations comme les punks-rockers rouennais cultes les Olivensteins, le musicien camerounais Francis Bebey ou encore Mobilisation générale, collection de chansons du jazz français des années 70.
L’homme s’est habilement diversifié en gérant le pressage de disques pour le compte d’une cinquantaine de labels dont il se pose en intermédiaire en négociant au mieux avec l’usine. Enfin, une source de revenus secondaire provient de la disponibilité du catalogue sur les plates-formes de téléchargement et de streaming via le distributeur Believe. Le tout lui permet de se dégager un salaire de l’ordre du Smic qu’il juge comme “un véritable privilège” pour ce secteur. Désormais, il se pose la question de l’avenir avec de grosses envies de pop. Outre le troisième album du trio Cheveu, le label va publier un album des dandies Dorian Pimpernel après le vinyle de l’album de La Femme et un single du néo-crooner franco-italien Alex Rossi l’an dernier, histoire d’élargir encore son spectre dans les extrêmes. “Je l’ai sorti en sachant que plein de gens allaient se moquer de moi, juste parce que ma fille adorait. C’est aussi pour ça que je fais un label.”
Cet article est paru à l’origine dans le Tsugi n°69 (février 2014)